Début Mars, l’Agence Spatiale Européenne et l’Agence Spatiale Norvégienne ont conjointement organisé un événement social au Nord de la Norvège : un groupe de 30 participants, sélectionnés suite à un appel à candidature, ont été invité à Tromsø . L’objectif était double : sensibiliser les participants aux enjeux liés à la météo spatiale, et partager cette aventure sur les réseaux sociaux. J’ai eu l’immense chance de faire partie des 30 participants, et j’ai ainsi pu assister aux différentes présentations d’experts, visiter des lieux insolites, et voir des aurores boréales ! Mais avant toute chose, qu’est-ce que la météo spatiale?
Une activité solaire permanente
Le Soleil est indispensable à la vie sur Terre : sans lui, il n’y aurait pas d’eau liquide à la surface de celle que l’on connait sous le nom de planète bleue. Il ne s’agit évidemment pas du seul élément indispensable, mais sans notre étoile, nous n’existerions pas. Le Soleil nous transmet, sous forme de lumière, de très importantes quantité d’énergie. Mais au delà d’un disque jaunâtre dans le ciel, que l’on attend lorsqu’il est caché derrière les nuages, et dont on profite agréablement en été, notre rapport au Soleil dans notre vie quotidienne est assez limité. D’ailleurs, entre les longueurs d’ondes que notre œil est capable de capter, et les impacts de l’atmosphère, on aurait tendance assez vite à considérer que le Soleil est un astre plutôt calme. Cependant, avec les bons instruments, on peut se rendre compte que le Soleil est tout sauf calme. Et justement, lorsque l’on parle de météorologie spatiale, on parle de l’activité de notre étoile.
Le Soleil est une gigantesque boule de plasma d’environ 700 000km de rayon, et situé à une distance de près de 150 millions de kilomètres de notre planète. Il possède un champs magnétique et est en rotation sur lui-même. Le Soleil possède donc un pôle magnétique Nord, et un pôle magnétique Sud, comme un immense aimant. On peut schématiser le champ magnétique du Soleil comme les lignes courbes reliant ces deux pôles, une sorte d’immense donut magnétique. Le plasma est extrêmement sensible aux champs magnétiques : du fait de ce fort champ magnétique, le Soleil éjecte continuellement de la matière dans l’espace. En effet, une partie du plasma qui compose la surface du Soleil suit ces lignes de champs . Certaines de ses lignes de champs sont fermées, c’est à dire qu’elle forme un arc de cercle uniquement : le plasma quitte la surface du Soleil, suite la ligne de champs dont l’arc de cercle le ramène en un autre point de la surface du Soleil. Mais certaines lignes, au contraire, sont dites ouvertes : lorsque le plasma suit ces lignes de champs, la matière est tout simplement éjectée dans l’espace : on appelle ce phénomène le vent solaire. Ce plasma, une combinaison de particules chargées électriquement à très haute température tend à se comporter comme un gaz à mesure qu’il s’éloigne du Soleil.
Cependant, tout n’est pas aussi simple, loin de là. D’une part parce que le champs magnétique du Soleil n’est pas figé dans le temps. Ses pôles magnétiques s’inversent tous les 11 ans environ : cela n’est évidemment pas un phénomène instantanée mais est un processus constant qui impacte plus ou moins fortement l’activité du Soleil. Ainsi, l’activité du Soleil alterne entre des période de forte activité et de faible activité avec une période d’environ 11 ans : cela signifie que deux maximum d’activité sont séparées de 11 années avec un creux d’activité entre temps.

Crédit : NASA’s Goddard Space Flight Center/Bridgman
Des sursauts d’activité complexes à anticiper
A cela s’ajoute un autre phénomène, qui complexifie encore l’activité de notre étoile. Comme mentionné plus haut, le Soleil est en rotation sur lui-même. Cependant, la vitesse de rotation n’est pas identique partout : la matière se déplace considérablement plus vite à l’équateur qu’au niveau des pôles. Cela altère localement le champs magnétique, et tord les lignes de champs. Lorsque le champs magnétique local est suffisamment important, des jets de matière peuvent être amené à suivre les lignes de champs. Si cela arrive généralement sous la surface du Soleil, parfois, cela peut arriver au-delà de la surface, où deux points sombres apparaissent alors : il s’agit des lieux d’où le filament le matière sort du Soleil, et où il rentre. Et ces tâches sombres vont toujours par paires ! Ces lieux apparaissent sombre car ils sont moins chauds que la surface du Soleil environnante. S’il restent extrêmement chaud, environ 3500°C, ces zones sont environ 2000°C moins chaud que le reste de la surface du Soleil. Et d’ailleurs, en suivant l’évolution des tâches sombres à travers le temps, on peut en déduire la rotation différentielle à l’origine du phénomène.
Il arrive parfois que ces lignes de champs locales, tordues, se croisent. Cela donne alors lieu à une incroyable explosion d’énergie. Le Soleil expulse alors une quantité gigantesque d’énergie à travers le système solaire. Ces éruptions solaires sont plus ou moins violente, et ont donc plus ou moins de conséquences sur Terre. Cependant, ces conséquences sont surtout matérielles, comme on le verra sans doute dans un futur article. En effet, le champ magnétique terrestre ainsi que notre atmosphère constituent deux excellentes protections contre les rayons X et gammas émis par notre étoile durant ces éruptions solaires. Néanmoins, cela reste un phénomène dangereux, d’une part pour ses conséquences matérielles sur les satellites par exemple, mais aussi parce que cela pourrait affecter dangereusement les astronautes durant les futures missions d’exploration spatiale, sur la Lune ou sur Mars. D’autant plus que, si les éruptions solaires produisent des flashs à la surface du Soleil, qu’il est possible quoi que difficile à observer, les rayons X et gammas émis durant ces événements voyagent eux aussi à la vitesse de la lumière : lorsque l’on détecte une éruption solaire, il est déjà trop tard pour tenter de s’en protéger…

Crédit: ESA & NASA/SOHO
On associe souvent ces éruptions solaires à un autre phénomène, pourtant bien distinct : les éjections de masse coronale (ou CME, pour Coronal Mass Ejection). Revenons aux lignes de champs : il peut arriver qu’elles soient si tordues qu’elles finissent par se briser. Dans ces conditions, plus rien ne cantonne le plasma à la ligne de champs ainsi briser, et il peut s’échapper de la surface du soleil. Contrairement aux éruptions solaires, dans le cas des CME, il s’agit de matière qui est éjectée : un gigantesque nuage de plasma quitte le Soleil, à très grande vitesse. Ces éjections vont venir s’ajouter, localement, au vent solaire dans lequel baigne le système solaire. Lorsque le Soleil expulse un nuage de plasma en direction de la Terre, cela lui prend quelques jours pour atteindre notre planète, où il va alors interagir avec son champs magnétique et l’atmosphère, et pourra avoir différentes conséquences en fonction de son intensité. Ces éjections laissent une trace au niveau de la surface du Soleil : localement, la température diminue du fait de la perte de matière. Cela laisse une énorme tâche sombre, bien plus grosse que celles mentionnées ci-dessus. Repérer ces tâches est d’ailleurs un moyen d’anticiper les arrivées de matière solaire.
Surveiller l’activité du Soleil s’appelle météorologie spatiale, et est un domaine indispensable de recherche : notre étoile reste sur de nombreux aspects très mystérieuse, et les conséquences de son activité peuvent être nombreuses et terrible sur Terre. Et c’est notamment pour nous sensibiliser à cela que l’ESA a organisé l’événement AuroraHunters. Et je développerais bien sûr ces thématiques dans mes prochains articles.

Crédit : SOHO/LASCO, SOHO/EIT (ESA & NASA)
Je tiens à remercier Anaïs Berthereau (@SpaceBoe) pour l’aide qu’elle m’a apporté sur cet article . Et bien entendu, merci à l’Agence Spatiale Européenne et à l’Agence Spatiale Norvégienne pour m’avoir permis de participer à cette aventure !
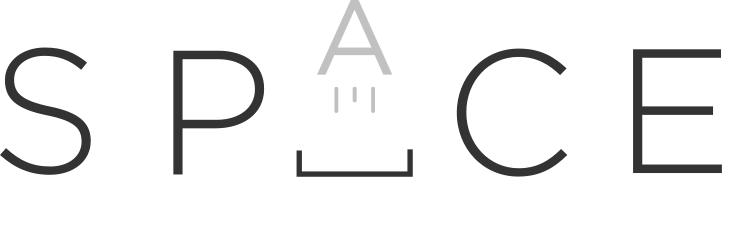

J’aime me promener sur votre blog. un bel univers agréable et un blog intéressant. Vous pouvez visiter mon blog récent. A bientôt.
J’aimeJ’aime